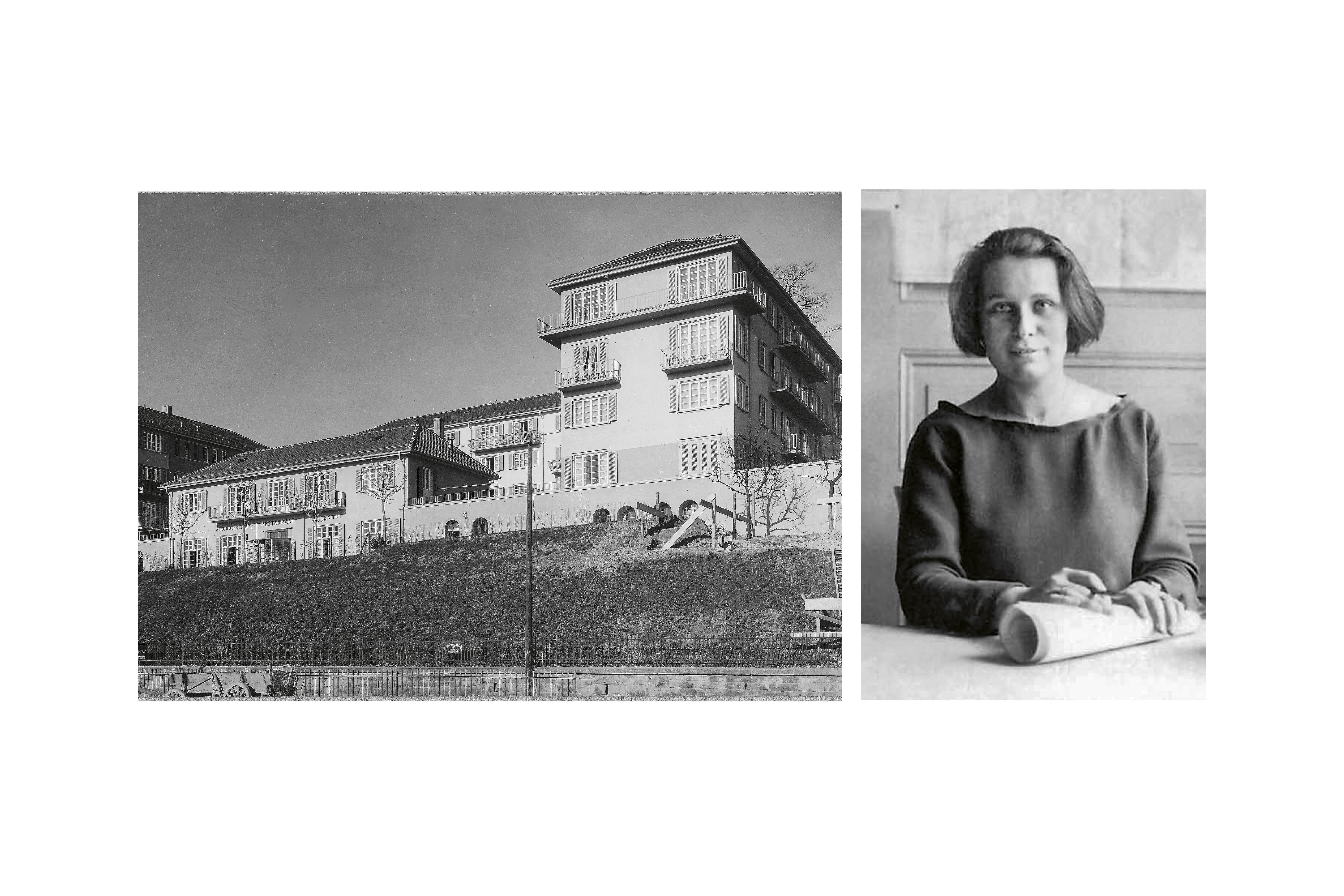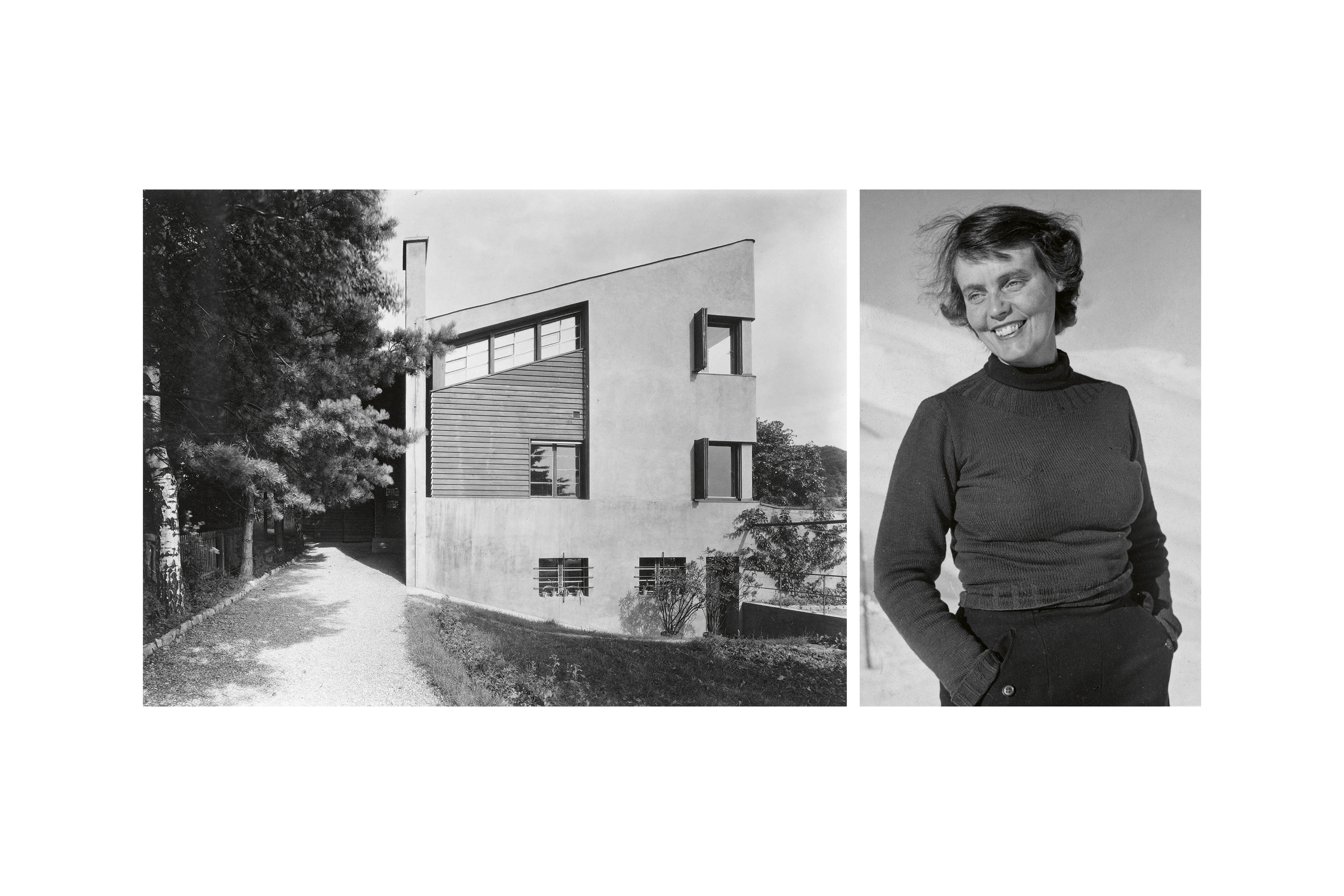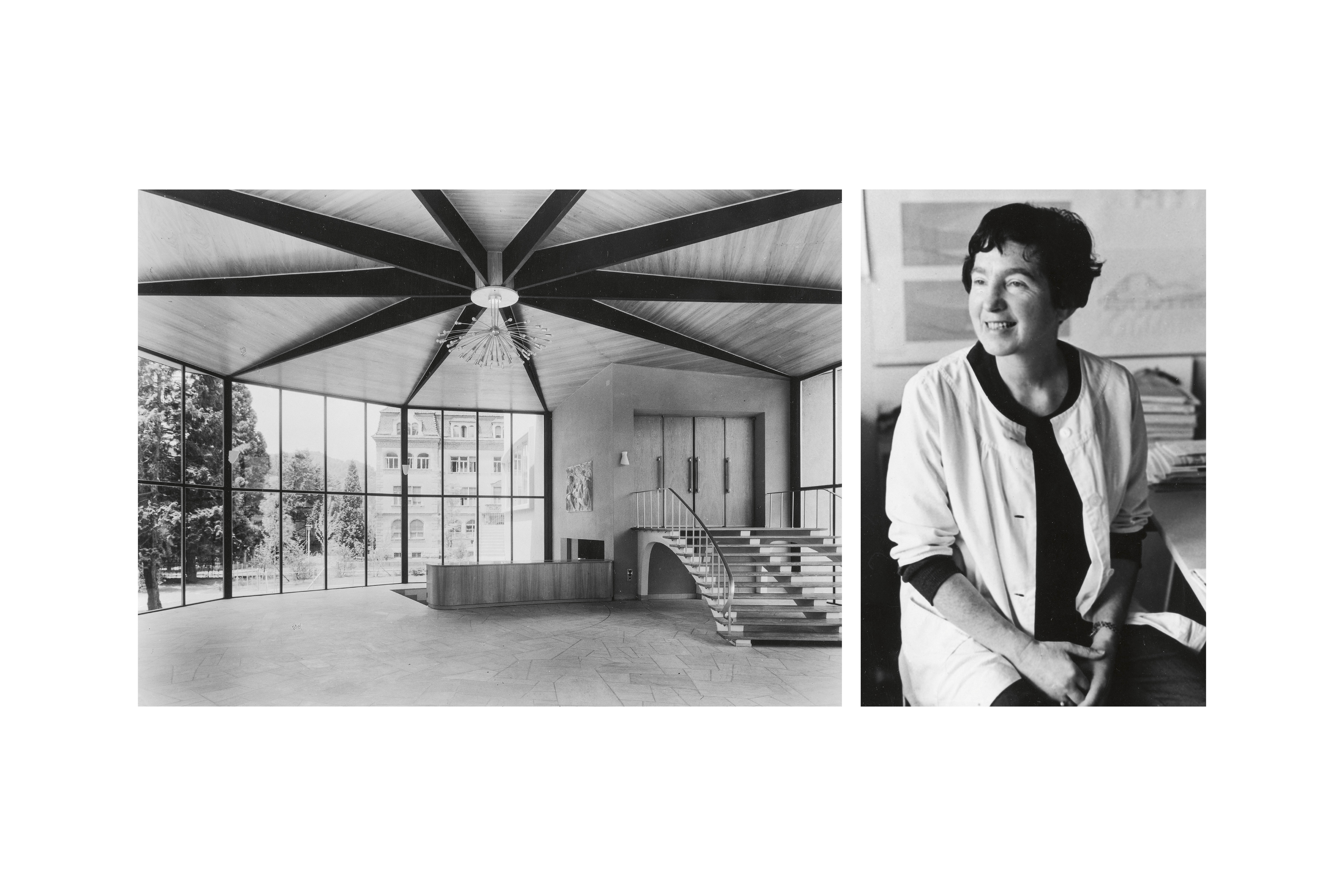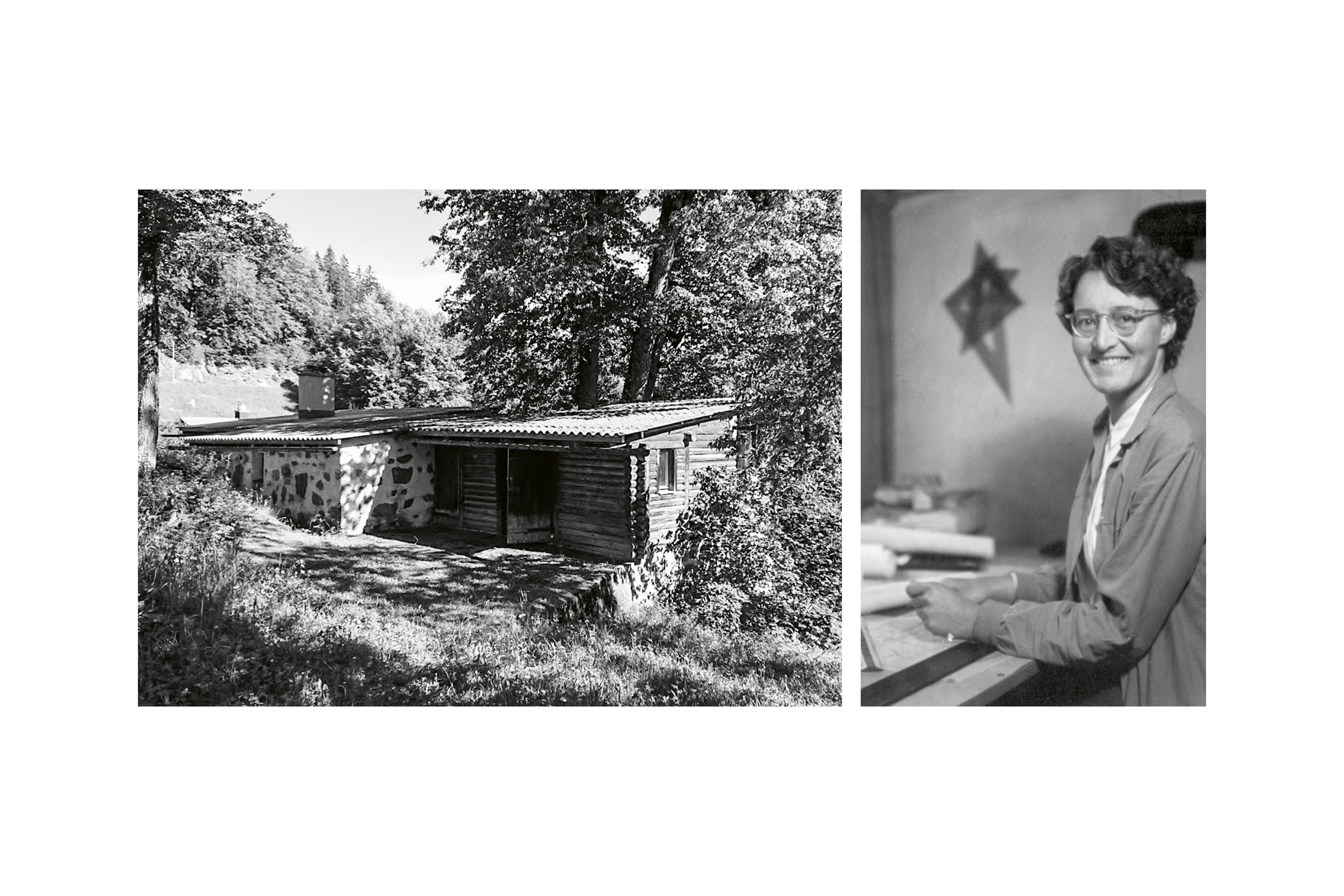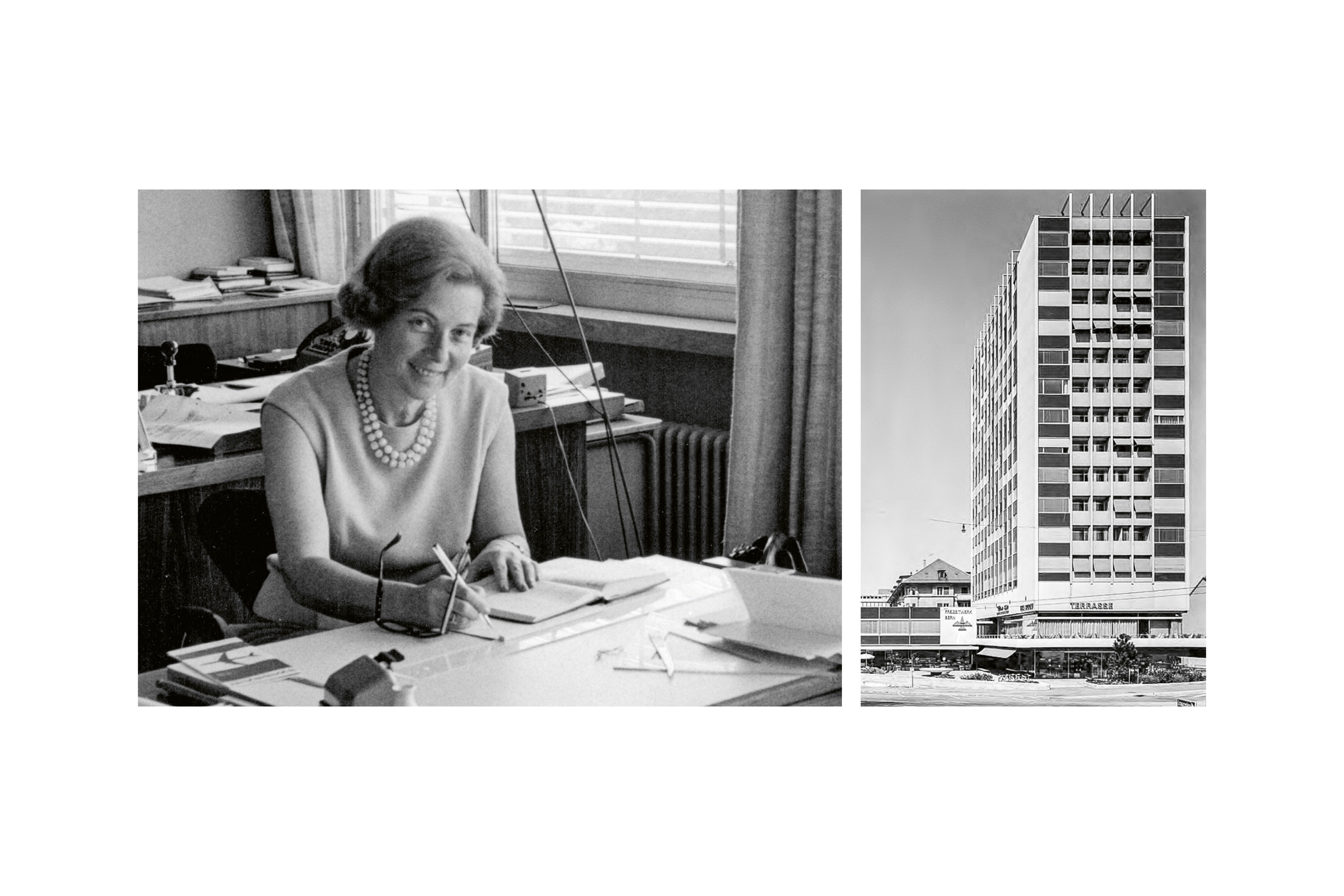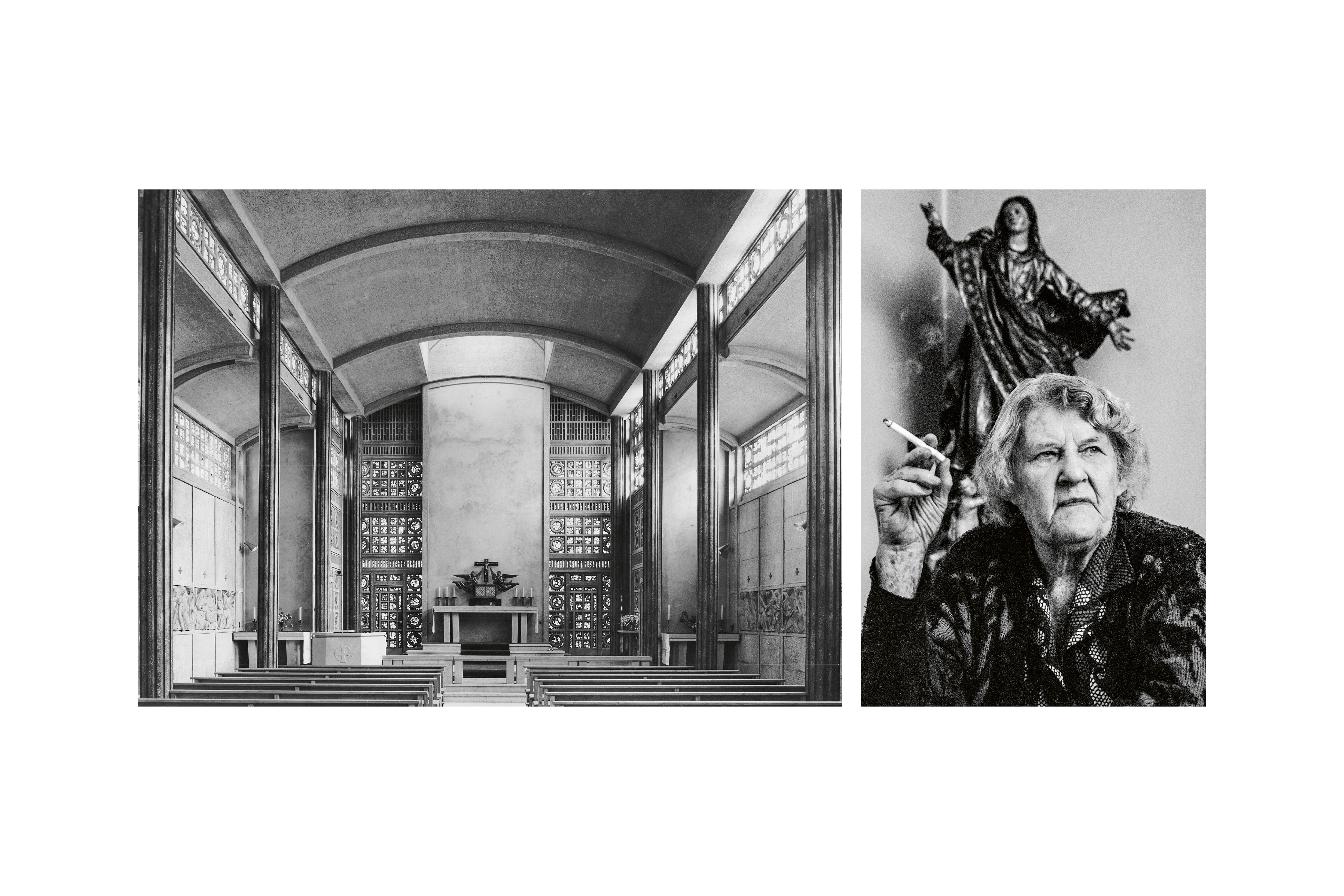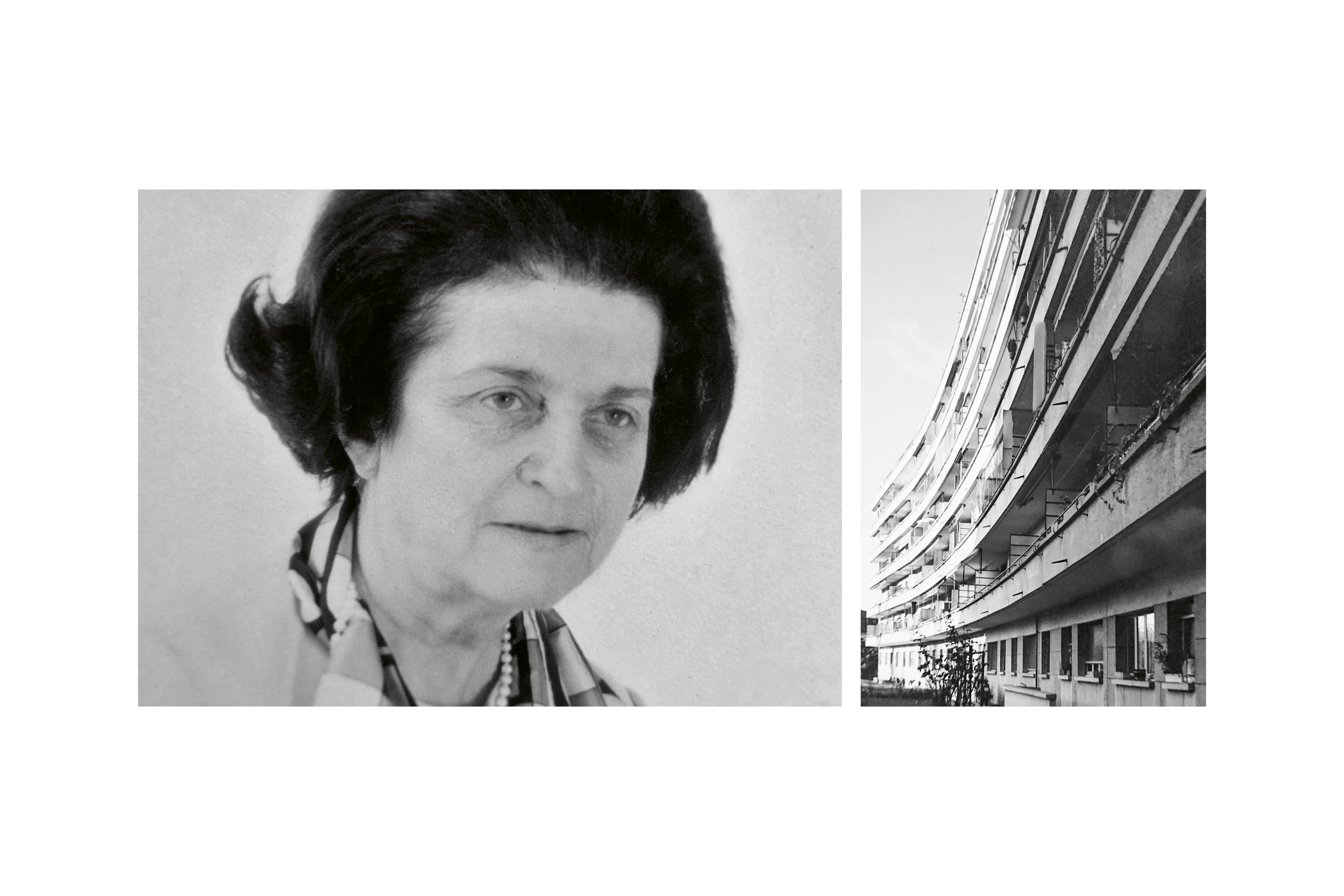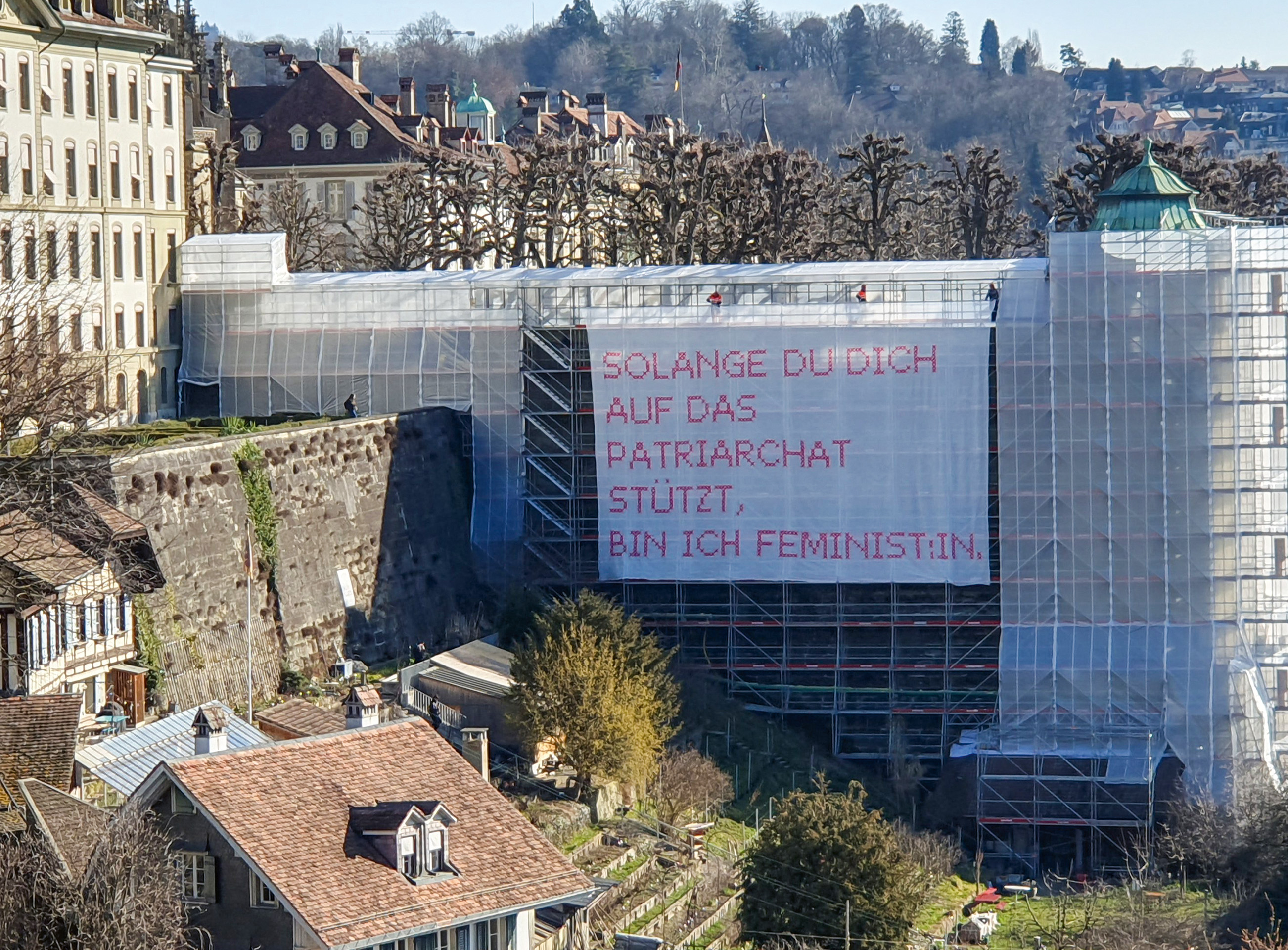Où sont donc passées les pionnières de l’architecture et leurs archives?
Autrice de la première thèse doctorale sur les «pionnières» de l’architecture suisse en 1992 (terme aujourd’hui consacré), Evelyne Lang Jakob s’est heurtée jadis à une absence de documentation. Pour composer son récit, elle est partie à la rencontre de ces architectes et en a appris bien plus sur les conditions auxquelles elles ont dû faire face pour exercer leur métier.
Qu’aujourd’hui, les femmes soient nombreuses à exercer la profession d’architecte, de conductrice de chantier ou de technicienne, qu’elles gagnent des concours d’architecture et occupent la une des journaux, nous paraît tout à fait normal. Pourtant nous oublions que nous devons cet état des choses au travail acharné de nombreuses pionnières.
En 1983, les archives de Lux Guyer venaient d’être déposées à l’ETH Zurich avec la condition sine qua non d’une valorisation immédiate1! Alors étudiante en architecture, je collaborai à cette exposition. Cette «matière» ne me laissant plus tranquille, j’endossai le statut de doctorante en 1987, profondément désireuse de partir à la recherche d’autres héroïnes oubliées de l’architecture. C’est ainsi que la plus grande aventure de ma vie commença2.
Mais comment a donc «cherché» la chercheuse? Tout d’abord, en épluchant les archives des diplômes en architecture du Poly de Zurich remontant à 1900, afin d’y repérer les prénoms féminins. Que de noms prometteurs y découvris-je, également dans d’autres écoles, comme les Beaux-Arts de Genève et les technicums! Puis, partie du dépouillement des revues professionnelles archivées en Suisse, j’élargis le sujet en me rendant à Paris, à Washington D.C. et surtout à Berlin, pour ne citer que ces exemples3. Alors, je fus submergée de noms, de pistes, de mouvements inédits et d’associations témoignant de l’implication des femmes dans l’architecture, comme le mouvement de l’architecture domestique aux USA4. Mais comment faire pour couvrir et dépouiller toute cette matière?
Making of
Au préalable, nous avons beaucoup discuté au sein du groupe genevois de Femmes Féminisme Recherche, dont je faisais partie, sur la façon de réunir des informations quand si peu est disponible. Comment mener des entretiens et en déterminer la valeur? La qualité du résultat, produit unique et subjectif, dépend de la situation et de l’état d’esprit des personnes au moment de l’interview (certaines femmes avaient par exemple abandonné la profession d’architecte) ainsi que du rapport entre l’intervieweuse et la personne interrogée. Plus les questions sont précises, plus le sont les réponses. J’ai constaté qu’au fil de l’entretien, les personnes pouvaient développer un récit de vie cohérent, dans lequel elles intègrent réussites et défaites, et montrent ainsi une partie de leur identité. Dans notre société, les révélations personnelles des femmes sont d’un grand intérêt car elles dévoilent leur culture privée qui n’a guère été étudiée. Si le récit raconté par une femme correspond à des histoires similaires racontées par d’autres femmes, ce nouveau savoir est validé et peut ainsi devenir une partie de l’histoire. Bien entendu, les récits de vie restent des récits de destins individuels basés sur la mémoire autobiographique.
Les interviews
Vint donc le temps de développer la méthode d’approche précise, avec l’objectif principal de documenter rôles et réalisations des premières femmes architectes en Suisse. Un questionnaire élaboré pour l’occasion à la main, je les rencontrai une à une. Grâce à la confiance qu’elles m’accordèrent sans compter lors de nos entretiens, j’obtins un savoir précieux et je pus noter leurs réponses respectives et les intégrer dans les portraits de ma thèse5. Parfois même, leur témoignage alla au-delà du simple entretien. Certaines me firent part de leur destin, de leurs difficultés et de leurs états d’âme et, pour moi, elles devinrent bien plus que des «donneuses d’information». Ce que ces femmes m’ont raconté était fascinant: c’étaient des échanges inédits, d’égale à égale, tous différents les uns des autres, sur la forme comme sur le fond.
Flora Steiger-Crawford par exemple, alors âgée de 90 ans, avait déjà écrit ses mémoires quelques années auparavant en guise de thérapie, après le décès de son mari Rudolf Steiger. Toute la partie conflictuelle de son passé ressurgit lors de notre entrevue et la frappa de plein fouet. La «princesse» d’antan (c’est ainsi que l’appelait son professeur de diplôme), la meilleure de sa volée, avait été vivement découragée par ses trois camarades de volée, par la suite associés sous le label HMS (Haefeli Moser Steiger) d’abandonner l’exercice de la profession en 1937, alors qu’elle se trouvait au zénith de son succès.
Il ne suffisait pas de tirer ces pionnières vers la lumière – il fallait surtout les ancrer dans la mémoire collective.
Berta Rahm, quant à elle, avait troqué en 1963 son travail d’architecte contre celui d’éditrice par manque de mandats, suite à ses nombreux litiges avec les autorités et par besoin de consolation. Elle avait beaucoup souffert de misogynie et de solitude dans sa vie de femme et trouvé du réconfort dans la recherche féministe et l’édition de ses grands classiques oubliés6. Toute sa vie, elle fut en quête de son identité (elle se demandait comment pouvait se définir une femme qui n’était pas mère) – et ne put trouver un compagnon pour la vie. Et, ultime coup du sort, alors qu’elle voulut participer à la Foire du livre de Francfort pour l’Année internationale de la femme en 1975, on lui fit remarquer que son stand spécialisé dans la littérature féministe était hors secteur. Quel affront – et quelle déception!
À la recherche des sources et technique de travail
Revenons à l’acquisition du fonds de travail: les femmes architectes interviewées n’avaient parfois plus d’archives personnelles et certaines ne tenaient qu’une liste sommaire de leurs travaux. J’ai d’abord dû établir un catalogue détaillé des projets et réalisations, identifier les bâtiments encore existants et leur position, partir à la recherche des plans et utiliser tout mon pouvoir de persuasion pour obtenir l’accès aux bâtiments. Puis, je consacrai un autre volet de ma recherche à la caractérisation des œuvres identifiées et à leur comparaison. À cet effet, je développai une méthode d’analyse adéquate mettant en relief la qualité architecturale des œuvres et d’éventuels points communs. Ainsi, j’étais prête à écrire ma thèse. Par la suite, je publiai la quintessence sous forme d’articles spécialisés et de notices encyclopédiques, puis dans des monographies7. À mon avis, il ne suffisait pas de tirer ces pionnières vers la lumière – il fallait surtout les ancrer dans la mémoire collective. C’est également dans ce but que je créai le label de «pionnières» – leurs existences étant si fragiles qu’il fallait les grouper dans une dénomination commune.
Principales difficultés des pionnières
À l’époque, le statut juridique de la femme laissait plus qu’à désirer en Suisse: jusqu’en 1988, les femmes mariées étaient dépendantes de leur mari. Elles n’avaient pas le droit de signer seules un contrat ou d’ouvrir leur propre compte en banque. Elles ne pouvaient pas s’engager dans un emploi rémunérateur sans le consentement de leur conjoint, et lui seul décidait du lieu d’établissement de la famille. Si elles étaient célibataires, on attendait peu d’elles – probablement à cause de leur «manque de maturité», car jusqu’en 1971, elles n’avaient ni droit de vote ni d’éligibilité. Leur destin était lié à leur condition de femme et celle-ci les rendait totalement dépendantes des hommes: qu’il soit père, mari, professeur, collègue de travail ou maître de l’ouvrage. Leur épanouissement et leur succès dépendaient de leur relation (subjectivement) bonne ou mauvaise avec eux. Et celle-ci, difficilement quantifiable, était bien plus importante que les éléments biographiques, les dates d’une construction, les lieux de résidence ou les diplômes obtenus et façonnait implacablement leur destin. Dans ce contexte, il s’agit de vraiment connaître ces pionnières, ou de ne pas les connaître du tout.
Quelques portraits8
Malgré tous les obstacles auxquels les pionnières en architecture ont été confrontées, et même si l’on ne s’en rend guère compte, les femmes (architectes) ont influencé le cours de l’histoire et la pratique architecturale en abordant de nouvelles thématiques.
Commençons par Maria Fierz (1878-1956), à qui son père interdisait d’étudier tout en lui laissant des moyens pour voyager. Alors elle partit suivre une formation de travailleuse sociale à Londres et utilisa son nouveau savoir de retour à Zurich, où elle fonda le Centre de liaison des associations féminines zurichoises. C’est grâce à cette structure que, dès 1926, Lux Guyer (1894-1955) put innover, en construisant les premiers ensembles de logement, comme la colonie Lettenhof à Zurich (aujourd’hui classée monument historique) pour femmes seules. Cette clientèle ne trouvait pas à se loger, car le modèle de vie d’une femme se déroulait au sein de la famille, qu’elle soit mariée, veuve ou célibataire! Avec cette réalisation, Guyer devança le fameux architecte Hans Scharoun et ses logements pour hommes célibataires, réalisés vers 1929 à Berlin, et la ville de Genève avec un même programme exécuté 35 ans plus tard. En intégrant un restaurant et une bibliothèque au Lettenhof, Guyer avait vingt ans d’avance sur Le Corbusier et ses «prolongements du logement»! De plus, en ouvrant sa Frauenschule für häusliche Arbeit pendant la récession de 1940, elle œuvra en faveur de la libération de la femme. Dans ces temps durs, où elle avait trop entrepris, elle glissa dans des difficultés de financement, mais put compter sur un réseau solide. Last but not least, Guyer sut bien choisir son mari, un ingénieur à la retraite, qui la soutint en signant les plans et les contrats de son bureau, qui compta jusqu’à 20 employés. Il l’épaula aussi dans ses charges familiales. Une contemporaine, Charlotte Enggist (1901-1992) qui n’était pas architecte et n’avait aucun réseau, fit faillite après avoir réalisé des immeubles spéculatifs, entre-temps démolis.
Flora Steiger-Crawford (1899-1991)9 montra la première en 1923 qu’une femme pouvait achever brillamment des études d’architecture au Poly et se profiler rapidement sur la scène architecturale. Son mari voulant expérimenter la vie au lointain Neubühl, lotissement avant-gardiste du bureau situé dans la banlieue zurichoise, elle perdit soutien et forces et dut finalement mettre fin à sa carrière.
Berta Rahm (1910-1998) et Lisbeth Sachs10 (1919-2002) réalisèrent l’avant-projet de l’Exposition suisse du travail des femmes (SAFFA) de 1958 mais par la suite ne reçurent pas le mandat, car elles n’avaient pas d’époux à l’arrière-plan, pouvant intervenir en cas de nécessité! Gret Reinhard (1917-2002) se positionna dès le début avec son mari Hans comme architecte travaillant en couple, comme bien d’autres de leur volée. La FAS ne voulant pas l’accueillir en son sein, mais seulement son mari, ce dernier leur dit: «Prenez d’abord ma femme!» Grâce à ce noble geste, elle y fut admise en tant que première femme en 1954 et ouvrit ainsi la voie à toutes les suivantes.
Claire Rufer (1914-1973), quant à elle, remporta un diplôme avec distinction et épousa un dessinateur qui devint homme d’affaires et ramenait des mandats à la maison. Elle était seule responsable de l’architecture. Le bureau Rufer devint l’un des plus grands de la place de Berne et a marqué le centre avec ses immeubles commerciaux et ses quartiers d’habitation.
Béatrice Hainard (1909-1949), première dessinatrice architecte diplômée des Beaux-arts de Genève en 1929, influença la production architecturale du bureau d’Antoine Leclerc dont elle devint l’associée, en remplaçant la tendance Heimatstil par une modernité résolue11. Malheureusement, elle fut obligée d’arrêter de travailler après son mariage. Quelle perte de talent!
Marie-Louise Leclerc (1911-2001) et Anne Torcapel12 (1916-1988), deux dessinatrices des Beaux-Arts ayant un père architecte, obtinrent ensemble le mandat public de l’agrandissement de la maternité de Genève. Ceci grâce à la pression exercée par les associations féminines de la place qui dénonçaient les conditions plus que vétustes dans lesquelles les femmes devaient accoucher. Ainsi les Genevoises pourraient dorénavant effectuer leur dur travail dans de petites salles individuelles, où les maris pouvaient les accompagner et les soutenir. Quelle révolution pour les hommes dorénavant impliqués dans la naissance de leur enfant et ainsi initiés aux soins à lui administrer par la suite!
Jeanne Bueche (1912-2000) ne commit aucune erreur de parcours. Restée célibataire comme Leclerc et Torcapel – probablement pour ne pas se faire interdire l’exercice de la profession – et ayant également un père architecte, elle sut cibler au bon moment une clientèle extrêmement puissante: l’Église13. Bueche se définissait comme un homme par son travail, s’engagea dans l’armée (lieu idéal pour établir un réseau) et chercha des mandats au bistrot. Entrant en relation avec les meilleurs artistes, elle devint par la suite la première femme membre de la Commission fédérale des Beaux-Arts. Elle sut assurer sa postérité avec brio: ses plans et projets sont déposés aux Archives de la construction moderne de l’EPFL (Acm) qui organisa une exposition de ses œuvres avec un catalogue à la clé14.
L’histoire avec des si
L’artiste Katharina Cibulka vient de faire une intervention devant le mur de soutènement de la collégiale de Berne en brodant les mots suivants sur une toile: Je serai féministe tant que tu te reposeras sur le patriarcat (p. 8). Eh oui, à l’heure actuelle, celui-ci est encore omniprésent, surtout dans les autocraties (et même aux États-Unis, malgré l’élection du président actuel à une majorité qui inclut les voix des femmes!). En Suisse, le droit de vote pour les femmes a seulement été introduit en 1971, puis il a fallu encore 17 ans pour libérer juridiquement les femmes mariées de la tutelle de leurs conjoints.
L’histoire de l’architecture n’est pas seulement faite par celles qui la font, mais aussi et surtout par ceux qui la racontent.
Puisque c’est l’une des questions soulevées par les commissaires du pavillon de la Suisse à la Biennale d’architecture de Venise, si Lisbeth Sachs avait conçu et construit ce pavillon en 1951… Il serait certes un peu différent et ce mandat aurait peut-être attiré l’attention sur l’existence des femmes architectes. Mais n’oublions pas qu’en Suisse à cette époque pour toute la société (y compris la majorité des femmes) il était impensable qu’une femme sache concevoir et réaliser un bâtiment public ou même une exposition. La même année, alors qu’elle avait gagné le concours du théâtre de Baden, elle dut accepter la collaboration d’un homme (qui pris la moitié du mérite) pour l’exécution. Peu de temps après, lors de la 2e SAFFA (1958), Sachs fut contrainte d’être épaulée par un individu du «sexe fort» pour construire le pavillon des arts, la Kunsthalle visitée par plus d’un million de visiteurs. Malgré ce «succès», le droit de vote fut refusé aux femmes l’année suivante. Précisons toutefois que l’idée du pavillon provenait de cet homme15 et que le choix des matériaux (plastique, béton, métal) n’était pas vraiment écologique et entravait même le bon fonctionnement de cette halle (chaleur suffocante et lumière éblouissante à l’intérieur ainsi que les nombreux angles morts entre les panneaux).16
Demandons-nous en outre: à quoi ressemblerait une architecture produite par les femmes? Longtemps socialisées différemment (ni les mêmes droits, ni les mêmes salaires et opportunités, avec la discrimination au travail, etc.), elles font d’autres expériences que les hommes; par exemple en donnant naissance à des enfants dont elles sont encore souvent les principales responsables. Par conséquent, dans la vie, dans leur logement et même dans l’usage de l’espace public, elles ont d’autres priorités. Toutefois, nous pouvons nous demander s’il est souhaitable de rechercher ou d’établir des différences entre les créations émanant de femmes, d’hommes ou d’autres genres. Toute caractérisation est synonyme de réduction et fort dangereuse. Si l’on définit une spécificité des femmes, celles-ci seront amputées de toute liberté de réalisation et réduites à une représentation précise. Ceci est aussi valable pour la façon d’organiser son bureau et de gérer son temps. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un bureau bien organisé et quelles en sont les valeurs? La visibilité et l’impact de la diversité dans les différentes professions du bâtiment est une thématique qui varie selon les endroits, les professions et les bureaux sélectionnés, dont les résultats ne peuvent que constituer les morceaux d’une mosaïque en constante évolution.
Faire et critiquer l’architecture fait référence à des valeurs et le concept de «qualité architecturale» est encore largement sous influence patriarcale. D’autant plus que l’histoire de l’architecture n’est pas seulement faite par celles qui la font, mais aussi et surtout par ceux qui la racontent. L’architecture comme son récit, les deux relèvent de l’art de la composition et de la construction d’une réalité, de la construction de LA réalité. La réécriture de l’histoire, accordant aux professionnelles la place qui leur revient, dépend de nous toutes et tous.
Evelyne Lang Jakob est architecte à Berne, chercheuse et rédactrice indépendante. Elle est l’autrice d’une thèse doctorale sur les premières femmes architectes de Suisse (EPFL, 1992).
Nos remerciements vont à Michael Leuenberger et la rédaction de la revue Art+Architecture pour la mise à disposition de certaines images qui accompagnent cet article.
À (re)lire ensuite: Jeanne Bueche et ses églises, article d'Evelyne Lang Jakob sur le travail de la pionnière jurassienne
Notes
1. Die Architektin Lux Guyer 1894-1955, catalogue d’exposition, ETH Zurich, Adolf Vogt, Dorothee Huber, Walter Zschokke (Hrsg.),1983. Voir également: Sylvia Claus, Dorothee Huber, Beate Schnitter (Hrsg.), Lux Guyer (1894-1955). Architek-tin, Zurich, 2009. Les archives d’Elsa Burckhardt-Blum, Flora Steiger-Crawford et de Lisbeth Sachs ont été déposées au gta Archiv de l’ETH Zurich. Celles de Berta Rahm, Claire Rufer-Eckmann et Anne Torcapel ont été détruites en grande partie. Aucune institution suisse ne voulait prendre les documents que je suis parvenue à sauver et que j’ai confiés à des institutions américaines, qui se sont montrées très intéressées. Pour Berta Rahm et Claire Rufer-Eckmann, consulter l’International Archive of Women in Architecture (IAWA – guides.lib.vt.edu/iawa). Marie-Louise Leclerc, partenaire d’Antoine Leclerc, m’a dit avoir passé beaucoup de temps à classer les archives du bureau pour les déposer aux Archives d’État. Quelle fut ma déception lorsque je constatai qu’elle avait remis les différents plans à leurs propriétaires dans l’espoir d’obtenir de nouveaux mandats…
2. Avec le coryphée de l’histoire de l’architecture moderne Jacques Gubler comme directeur de thèse, alors que j’étais enseignante à l’École d’architecture de l’Université de Genève (EAUG).
3. En tant que chercheuse dès 1989 à la Technische Universität de Berlin, grâce à une bourse du Fonds national suisse.
4. Par exemple, l’Union internationale des femmes architectes (UIFA) qui organisait régulièrement des congrès auxquels je participai. Voir aussi l’International Archive of Women in Architecture (IAWA) de Blacksburg, Virginia, dont je fus membre du board of advisors.
5. Evelyne Lang, Les premières femmes architectes de Suisse, Thèse de doctorat de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, 1992. L’ouvrage est déposé en accès libre sur le site internet de l’autrice: jpar.ch/desc/DissertationEvelyneLang.html
6. Par exemple, Geschichte der Frauen de 1779 de William Alexander, Verteidigung der Rechte der Frauen I, II u. III de Mary Wollstonecraft (1759-1797), œuvres de Hedwig Dohm (1831-1919), de Flora Tristan (1803-1844) et autres
7. Cf. notices sur F. Steiger-Crawford, M.– L. Leclerc, B. Rahm, G. Reinhard, C. Rufer et A. Torcapel dans le Dictionnaire historique de la Suisse: hls-dhs-dss.ch/fr/articles. Cf. scripts de mes cours à la Freie Universität Berlin (1993-1997). Cf. projet de mémoires Berliner Jahre.
8. Voir l’édition de K+A (Kunst + Architektur in der Schweiz – Art + Architecture en Suisse) 1/2024 Femmes et architecture, qui contient une ample bibliographie actuelle.
9. Voir la monographie Flora Steiger-Crawford 1899-1991, ed. Jutta Glanzmann, gta Verlag, 2003
10. La monographie de Rahel Hartmann Schweizer, Lisbeth Sachs: Architektin, Forscherin, Publizistin, Zurich, gta Verlag, 2020, a été publiée dans une version traduite en anglais sous le titre Lisbeth Sachs: Animate Architecture (gta Verlag, 2025)
11. À la demande de sa fille Marie-Louise, Antoine Leclerc l’a engagée dans son bureau. Personne ne voulait d’elle après ses études, car c’était une femme.
12. Il n’existe pas à ce jour de monographie consacrée à Anne Torcapel mais un mémoire de Master de l’UNIGE lui a été consacré: Guy Chevallier, La carrière de l’architecte genevoise Anne Torcapel (1916-1988). Tentative d’inventaire, mémoire de Master en histoire de l’art UNIGE, sous la direction de Leïla el-Wakil, 2012
13. Evelyne Lang Jakob, Les églises de Jeanne Bueche, espazium.ch, 12.07.21
14 Philippe Daucourt, Jeanne Bueche architecte, Acm–EPFL, 1997
15 Rahel Hartmann Schweizer, Lisbeth Sachs, op. cit., p. 109
16 Idem, p. 112