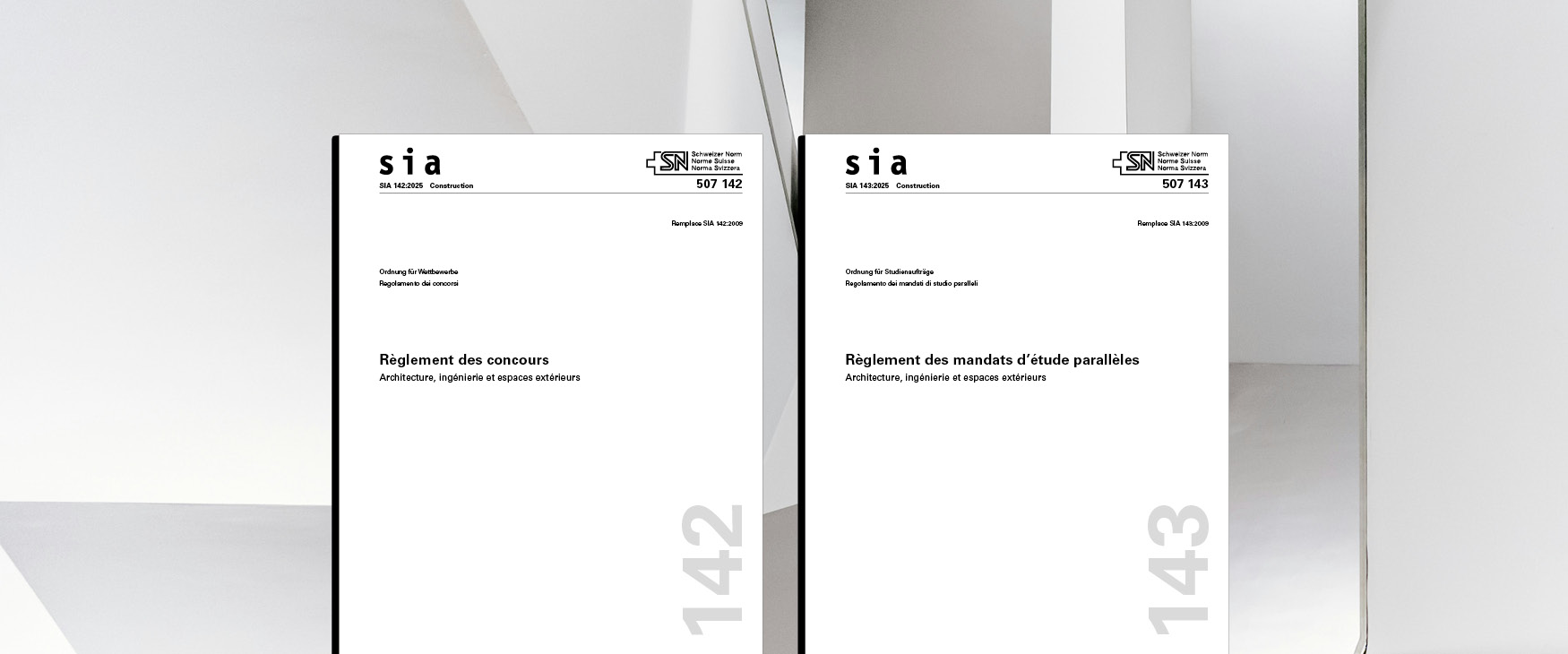Demain c’est loin
Aurait-on aperçu le futur de la construction lors du concours pour le centre des sciences physiques et mathématiques de l’UNIGE?
Le centre des sciences physiques et mathématiques de l’UNIGE nécessite un nouveau pôle, un nouveau visage pour attirer chercheurs et chercheuses du monde entier. Dans la foule des rendus (42 au premier tour, 11 au second), une expression aussi bien architecturale que structurelle se détache avec clarté. Un langage inspirant, celui du réemploi – non subi, mais affiché avec fierté –, du bois, de la pierre, du béton recyclé et de la terre. Des espaces hauts et que l’on devine frais, aux plafonds voûtés. Une architecture moins vitrée, qui utiliserait l’inertie thermique, et dont la structure serait inspirée par d’autres latitudes (l’église de San Procolo à Vérone, la Mezquita de Cordoue).
De l’aveu du jury, «la grande force du projet (Argile, Sylla Widmann architectes, 2e rang, 2e prix) réside dans une attitude très engagée dans ses choix constructifs», qui «préfigure probablement l’évolution future du domaine de la construction». Questionné sur sa relégation au second rang, le président Marc Collomb confirme nos doutes: la peur d’abandonner un maître d’ouvrage avec un projet trop ambitieux l’a emporté1.
Une université au cœur du tissu urbain
À Genève, la Faculté des sciences est historiquement établie le long de la rive droite de l’Arve, résultat de la double volonté de regrouper enseignement et recherche, ainsi que de maintenir l’Université au cœur du tissu urbain. Aujourd’hui, le remarquable institut de physique moderne et ses satellites réalisés par Denis Honegger dans l’après-guerre sont devenus exigus pour les besoins universitaires, dont les activités se sont éparpillées depuis sur plusieurs sites.
L’objectif du concours est donc de construire un nouveau bâtiment au quai Enerst-Ansermet, là où se situe déjà une partie importante de la faculté. Celui devra dialoguer avec l’institut existant, qui regroupe les sciences physiques et mathématiques. Pour la forme, une densification en socle et en hauteur, qui entrerait en résonnance avec la tour RTS et la tour des Vernets (FHV), actuellement en chantier, se justifierait.
Ce n’est pas n’importe quel bâtiment qui est attendu : le MO veut un phare, dont le coût de l’ouvrage CFC 2 et 4 est admis à 123 mio CHF HT. En sciences physiques et mathématiques comme dans le reste du monde universitaire «la compétition mondiale est importante (…) et l’UNIGE est en concurrence avec de grandes universités qui construisent des infrastructures capables d’attirer les meilleurs chercheuses et chercheurs.»2
Construire, vraiment ?
Si Sylla Widmann architectes proposait une vision, d’autres sont allés encore plus loin en se demandant : faut-il même le construire, ce phare? C’est la question posée par les architectes de Sujet Objet et de Kosmos, écartés au premier tour, qui interrogeaient la pertinence d’édifier un autre immeuble de grande hauteur, alors qu’il existerait plus de 315'000 m2 de bureaux vides sur le territoire genevois et que la tour de la RTS3, à deux pas du site, déplacera bientôt 60% de ses activités sur le campus de l’EPFL. «C’est le territoire genevois existant qui doit devenir le campus de l’UNIGE (qui se répartit aujourd’hui sur 70 adresses différentes) et non de nouvelles constructions dont l’impact environnemental n’est plus acceptable», proclament les jeunes architectes. Question pertinente mais écartée par le jury: les facultés scientifiques ont besoin de laboratoires trop complexes pour être intégrés dans une tour existante.
Le théorème de Marguerite – est-on tombé dans le panneau (solaire)?
Au terme d’une procédure de longue haleine, en deux tours, c’est le projet Le théorème de Marguerite de Burckhardt Architecture qui s’est imposé. Dans ce rutilant édifice, émergences métallisées fichées dans une canopée de béton, on distingue quatre identités fonctionnelles: une tour de recherche, un plot d’enseignement composé d’auditoires et de salles de travaux pratiques, un socle commun réunissant chercheur·euses et étudiant·es autour d’un programme collectif, ouvert au campus et à la ville, et enfin des espaces en sous-sol qui abritent les laboratoires.
L’expression du bâtiment, trop vitrée pour le jury lors du premier rendu et donc exposée à la surchauffe estivale, exploite pour le rendu final un dispositif largement testé et approuvé dans le système universitaire4: une coursive pour l’interface extérieure intérieure, utile pour la maintenance et comme brise soleil, équipée ici de panneaux photovoltaïques, et qui confère à la façade une profondeur bienvenue.
Si le projet lauréat n’est pas le plus audacieux, il est bien celui qui a répondu avec le plus de maestria non seulement au programme, mais aussi en exécutant avec efficacité le travail volumétrique – le point décisif d’un point de vue énergétique et écologique, qui importe plus que le choix du matériau.
Le prix du choix
À l’inverse des mesures trop souvent opaques et controversées de l’EPFL5, il est toujours rassurant de constater que d’autres maîtres d’ouvrage, ici l’office cantonal des bâtiments (OCBA) et l’Université de Genève, s’acquittent de leurs responsabilités. Pour le concours pour le centre des sciences physiques et mathématiques de l’UNIGE, toutes les conditions étaient réunies pour s’interroger en profondeur et de manière transparente sur le futur de l’université et sur la forme que celle-ci doit prendre : un (très) large jury (31 expert·es !), un cahier des charges détaillé, une procédure ouverte à deux degrés visiblement attractive et certifiée SIA 142.
Toutefois, un point interroge. Comme l’a souligné le président du jury Marc Collomb, c’est un beau cadeau qui a été offert par les équipes concurrentes au maître de l’ouvrage : « 42 équipes ont investi temps, savoir-faire et ressources pour le premier tour, sans rémunération. On estime que cet investissement, toutes équipes confondues, représente entre 3 et 4 millions de francs ».
Et vous, que préférez-vous ? À droite, les procédures sur sélection, voire sur invitation, menées tambour battant et dont les projets sortent de terre en un temps record5; à gauche, les concours ouverts où l’énergie et l’argent des bureaux coulent à flots, pour des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de cet investissement. À L’UNIL, on nous a confié que le nouveau bâtiment pour les sciences humaines, dont le concours avait attiré 43 équipes en 2022 et dont nous avions parlé à l’époque, ne se construira finalement pas.
Notes
1. Un syndrome semblable avait frappé l’UNIL en 2022 pour le concours pour le nouveau bâtiment pour les sciences humaines. Lire à ce sujet l’article de Marc Frochaux, « Déjà-vu à Dorigny : Prudence est-elle mère de toutes les vertus (écologiques) ? », TRACÉS 01/2022.
2. Pour poursuivre ce sujet, lire aussi: « Campus : l’architecture comme media, entre espace et image », TRACÉS 06/2023.
3. Début juillet, on annonçait le rachat possible de la tour RTS par la Fondation Hans-Wilsdorf (communiqué de presse du 01.07.2025).
4. Le Batochime par exemple, conçu en 1994 à l’UNIL par Atelier Cube, dont Marc Collomb est l’un des fondateurs.
5. Voir à ce sujet les MEP pour la rénovation de la Coupole à l’EPFL, remportés par Dominique Perrault Architecture et traités dans l’article : « À l’EPFL, toujours la loi du Far West », TRACÉS 10/2023. Ou plus récemment encore les résultats du concours pour le Centre de mathématiques Bernoulli à l’EPFL, auquel seuls deux bureaux ont participé. L’organisation opaque de la procédure, ainsi que la suppression d’une activité agricole exemplaire sont dénoncées par plus de 500 citoyen·nes, agriculteur·ices, agronomes, chercheur·euses et professionnel·les de l’environnement bâti dans une lettre ouverte. Plus d'informations sur preserverbassenges.ch
6. Le chantier de la rénovation et extension de la Coupole a commencé au début de l’été.